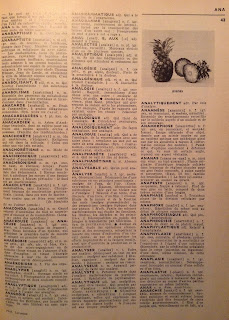Laisse venir paraît le 1er octobre prochain aux éditions La Marelle / Le Bec en l'air, dans la collection Résidences. C'est un texte que nous avons écrit, avec Pierre Ménard, il y a déjà deux ans et dont le principe est simple : effectuer en dix étapes un trajet Paris-Marseille, voyage virtuel nécessitant seulement un accès à Google Street view. Je n'y reviens pas cette fois-ci car nous en avons déjà parlé tous deux, que ce soit ici ou sur Liminaire, le site de Pierre. Et surtout, Pierre vient de concocter une très belle vidéo de présentation, que voici :
Ce que j'aimerais plutôt, au moment où le texte est enfin accessible, c'est expliquer comment travaille le temps : celui qu'on passe à effectuer des recherches et à écrire le texte ; les strates de temps que celui-ci contient ; le temps de Street view lui-même ; le temps écoulé depuis la fin de la rédaction (joue-t-il ou non sur la perception qu'on en a ?).

Je ne sais plus combien de temps m'a pris ce texte, très différent de celui de Pierre et plus court que le sien. Ce dont je me souviens, ou plutôt crois me souvenir, c'est de l'avoir écrit dans mon lit, et que la recherche d'images comme la rédaction m'ont semblé longs, denses. Je ne sais plus si j'écrivais sous ou sur ma couette, ou alternativement, ce qui a son importance. Sous la couette : au chaud, encore proche du sommeil, du rêve, un état qui permet de se sentir en sécurité, de pouvoir laisser émerger les souvenirs sans rien qui attaque. Au-dessus : en position semblable, mi-assise, mais déjà plus près du bureau, de la chaise, de l'air frais qui pourrait entrer par la fenêtre, circuler, obliger à se lever.
Laisser venir les souvenirs : d'enfance, de jeunesse, de fantasmes, de voyages, de vacances, de travail, mais de passé très proche aussi.
Laisser venir des images de la ville qui n'ont rien de commun avec celles des souvenirs. Et même celles de villes où l'on n'a jamais mis les pieds, dont le nom, seul, importe.
(ici à Sète la rue du chant des vagues)
Ecrire, donc, dans le lit et chercher sur Street view à capturer ce qui permettra de faire avancer le texte, de rebondir, de se projeter. Voilà qui prend un temps fou, car que choisir ? Un lieu dont on a l'image exacte en tête, comme ce fut le cas pour Auxerre par exemple (en retrouvant une place où je buvais un café, instant de pause d'un trajet, j'ai eu l'impression d'une incursion directe dans ma mémoire) ? Ou un arpentage permettant de se perdre, de longer des rues jamais vues ? A Sète, j'ai découvert un couple d'amoureux s'embrassant sur un boulevard et je l'ai tout de suite perdu, ne l'ai jamais retrouvé, malgré mes recherches.
(si ça vous dit, n'hésitez pas : c'était près du port)
(quelque part par là)
Cependant, je n'ai pas seulement convoqué des souvenirs. Je me suis servie des images, mais aussi du présent, celui de l'écriture. A l'époque, même à avoir déjà écrit Décor Lafayette, la parution de Franck m'occupait encore, des mois après. Ou plutôt ce qui m'occupait, c'était l'état d'intensité dans lequel la publication de ce livre m'avait mise : quelque chose de très fort mais aussi d'épuisant. Comment rester à ce niveau-là ? me demandais-je. Et était-ce souhaitable ? Je sentais bien que non mais sans vouloir que ça s'arrête : ce qui s'insinue dans les souvenirs de Laisse venir.

Le présent seul s'en est mêlé, de toute façon : alors que je devais aller parler de
Franck à la médiathèque de Saint-Etienne, rencontre qui était prévue depuis l'année précédente, ma grand-mère est morte. Il se trouve que c'était sa ville... Il a fallu, en quelque sorte, faire un double voyage. Ainsi, le brouillage vie / écriture tresse le texte de
Laisse venir, lequel est troué, elliptique, oscille entre enfance, jeunesse, fiction et adresse à un
tu qui change de nature, représente parfois quelqu'un, parfois un texte, parfois l'auteur du texte. Des pertes de repères qui disent, je crois, ce qui travaille en nous quand nous finissons d'écrire et portons le livre : ce qui traîne encore, ne s'efface pas.
Oui, c'est ça, quelque chose travaille, quelque chose que j'ai d'abord nommé
il dans mon chapitre sur Paris - au début du voyage, donc.
Il c'est l'autre : le texte, le lieu, le monde, les livres des autres, ceux qui les écrivent et ceux qui nous lisent : tout ce qui déclenche en nous quelque chose de neuf, nous remue, nous fait tanguer. Mais comme c'est abstrait, ce
il, difficile à cerner, en écrivant j'en ai fait un
tu.
(le
tu contenu dans
Laisse venir)
Quelque chose demandait à être nommé tout en continuant d'échapper alors j'ai joué sur les pronoms, sur leur ambiguïté : abstraits, interchangeables et pourtant liés à un être, à un objet, à un lieu. Je me souviens : j'ai retravaillé plusieurs fois le passage où j'évoque ce moment de bascule sans jamais pouvoir m'y confronter vraiment, me bagarrer avec. Drôle d'expérience.
C'est que Street view est l'étrangeté même : un miroir soi-disant fidèle du réel - mieux : du réel du monde entier - et c'est conjointement une source de fiction. Ce qu'on voit n'y est plus et nous n'y sommes pas. A jamais ailleurs, à jamais absents.
Street view est le monde sans nous. L'après nous. Et où sont nos traces ?
Deux ans après, que reste-t-il en moi de ce texte ? Je ne sais pas, je continue de ne pas le savoir tandis que je relis les épreuves, supprime des sauts de ligne, me pose des questions sur les notes en bas de page. Il m'échappe continuellement. J'ai beau le connaître presque par coeur, je ne sais toujours pas d'où il vient, où il va. J'ai suivi le conseil de Pierre, qui a choisi le titre : j'ai laissé venir. J'aurais pu l'écrire autrement, en proposer d'autres versions. Il aurait pu être plus unifié, narratif. Mais non. Il a fallu qu'il vienne comme ça, avec ce qui résistait, ce qui insistait.
Il commence dans le métro, "en vrai", à Paris, se poursuit dans deux villes de banlieue que je confonds, où je ne suis jamais allée (Antony, Asnières). Puis on part en voiture (Auxerre, Dijon, Lyon). Puis dans la petite enfance (Saint-Etienne, Béziers, Valras-Plage). Ensuite on reprend la voiture, on s'arrête à Sète. Enfin, c'est Marseille en train.
On y trouve, de mon côté :
un thé à goût d'huître, des amours secrètes, la villa Arpel, une maison floue, un chocolatier, une bague oubliée, des avions de chasse, un manteau rouge, des chambres d'hôtel, deux oncles, un photomaton, un détour par Rouen, un grand-père qui ne veut pas se baigner, un café sur le port, un masseur dans le train.
Et chez Pierre, par exemple :
Une pile de pont, le passage du Désir, des dolmens, un château, une main tendue, une porte qui claque, le
Café des sports, deux salons de coiffure, des platanes, une femme qui regarde dans un télescope, une anecdote sur Carcassonne, un étang d'or, les marches d'un grand escalier...
Tout cela est traversé par le temps de Street view, avec ses saisons, ses années qui diffèrent selon le moment où roule la street car. Et je ne suis pas très étonnée d'avoir choisi, pour illustrer ce post, des captures d'écran qui sont et ne sont pas dans le livre :
Laisse venir c'est une sorte de mouvement, extérieur intérieur, intérieur extérieur permanent, doublé par ce qui, du texte de Pierre au mien, du mien vers le sien, se répond, s'éloigne, relance, fait écho.